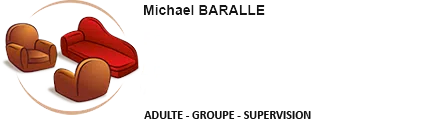JOUIR DE L’OBJET OU JOUIR DE L’IDENTITÉ: EST-CE UNE ALTERNATIVE ÉTHIQUE CRÉDIBLE POUR LE SUJET CONTEMPORAIN?
JOUIR DE L’OBJET OU JOUIR DE L’IDENTITÉ: EST-CE UNE ALTERNATIVE ÉTHIQUE CRÉDIBLE POUR LE SUJET CONTEMPORAIN?
JOUIR DE L’OBJET OU JOUIR DE L’IDENTITÉ: EST-CE UNE ALTERNATIVE ÉTHIQUE CRÉDIBLE POUR LE SUJET CONTEMPORAIN?
Le sujet pose comme présupposé à son traitement deux axiomes : qu’il existerait quelque chose comme un « sujet contemporain » et qu’il serait face à une alternative éthique lui imposant de choisir entre jouissance de l’objet et jouissance de l’identité. Il pose que cette alternative devrait être reçue comme étant crédible ou non, comme pouvant faire un certain acte de foi, de croyance, d’engagement dans l’une de ces alternatives. Si cette alternative doit être crédible, c’est aussi qu’il faudrait penser que l’éthique nous engage dans notre rapport à la vérité. Et c’est peut-être sur ce point que se trouve l’enjeu. Car la question de l’éthique pose aussi celle du rapport que le sujet entretien avec une certaine vérité. Au-delà de toute obligation, de tout code moral, que reste-t-il au sujet du côté de l’éthique qui fait qu’une telle alternative n’est pas souhaitable ? Entre « passion identitaire d’un côté, et jouissance désarrimée de l’objet[1] » de l’autre, pourquoi faudrait-il seulement trouver une troisième voie ? [1] Cathelineau, Pierre Christophe, L’Economie de la jouissance, EME Editions, 2019.